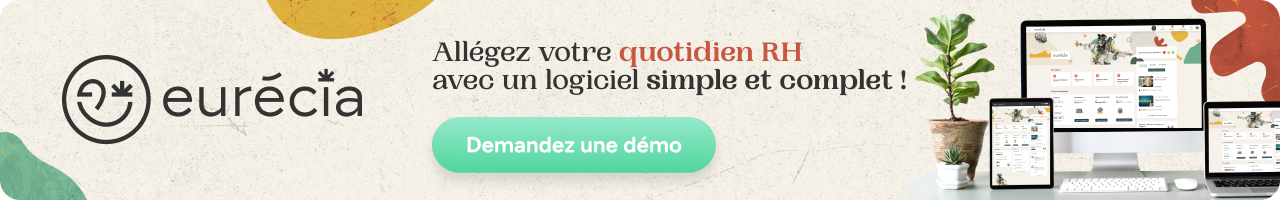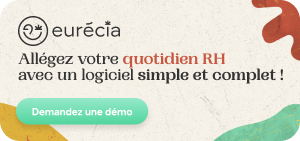Veille & actualités RH3 minutes
Veille & actualités RH3 minutes
Mis à jour le 17/07/2025
Sommaire
Le décret articule ses exigences autour des niveaux d’alerte émis par Météo-France (vigilances jaune, orange et rouge), avec une logique d’escalade dans les mesures à prendre. Pour les employeurs, il ne s’agit plus d’une simple recommandation, mais bien d’un cadre réglementaire contraignant à intégrer dans la gestion des risques professionnels.
Aménagement des postes et horaires : une adaptation attendue, mais souvent sous-estimée
L’une des principales obligations concerne l’adaptation des postes de travail : mise à disposition de protections solaires, réorganisation des plages horaires, création d’espaces de repos ombragés ou climatisés. Dans la pratique, ce type de mesures suppose une concertation étroite entre les services RH, les managers opérationnels et, si présents, les représentants du personnel.
Pour les RH, le vrai défi est souvent celui de la granularité : il ne suffit pas de déclencher un plan canicule global. Il faut pouvoir identifier, site par site et métier par métier, les expositions réelles. Une logique de cartographie fine s’impose, car tous les salariés ne sont pas exposés de la même manière, même au sein d’un même établissement.
3 litres d’eau, un seuil réglementaire qui engage
Autre nouveauté : l’employeur doit désormais garantir 3 litres d’eau fraîche par salarié et par jour lorsqu’il n’y a pas d’eau courante accessible sur le lieu de travail. Ce seuil chiffré est une première dans la réglementation. Il impose une logistique rigoureuse, notamment dans les zones isolées ou les chantiers temporaires.
Sur le terrain, cela interroge directement les pratiques RH en matière de sous-traitance : qui est responsable de l’approvisionnement lorsque plusieurs entreprises interviennent sur un même site ? Un DRH averti veillera à formaliser cette répartition dans les clauses contractuelles et les plans de prévention.
DUERP et nouvelles exigences de traçabilité
Le décret impose également une mise à jour du Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) pour y intégrer le risque chaleur. Trop souvent considéré comme un simple support de conformité, le DUERP devient ici un levier stratégique pour anticiper les désorganisations (absentéisme, baisses de productivité, tensions sociales…).
À noter que ce point renforce aussi les attentes de l’Inspection du travail. Depuis le 1er juillet, elle peut mettre en demeure une entreprise sous huit jours si aucune mesure adaptée n’est prévue ou appliquée lors d’un épisode caniculaire.
D’un point de vue RH, cette pression réglementaire doit inciter à sortir d’une gestion réactive pour entrer dans une logique de planification saisonnière. Tout comme on prépare un plan neige ou grippe hivernale, les plans chaleur doivent être pensés en amont, intégrés aux process d’onboarding des saisonniers et reliés aux indicateurs de santé sécurité au travail.
Formation et culture de la prévention : un levier souvent négligé
Ce décret est l’occasion de souligner l’importance de former les salariés aux gestes de prévention et aux signaux d’alerte liés à la chaleur. C’est un point encore trop peu intégré dans les plans de formation annuels. Pourtant, la sensibilisation peut avoir un impact direct sur la réduction des accidents du travail, notamment les malaises ou les chutes induites par une déshydratation ou un coup de chaleur.
Un expert RH verra là une opportunité d’engager les managers de proximité, souvent les premiers témoins des situations à risque. Former ces relais internes à détecter les signaux faibles (fatigue inhabituelle, perte de concentration) permet de gagner en réactivité et d’ancrer une vraie culture de prévention.
Enjeux sociaux et dialogue avec les IRP
Il ne faut pas sous-estimer l’impact potentiel de ces nouvelles règles sur le dialogue social. Certains secteurs voient déjà émerger des revendications autour des équipements vestimentaires (comme les éboueurs de Niort ayant obtenu le droit de travailler en short en alerte orange) ou des temps de pause supplémentaires. Ce sont autant de signaux à intégrer dans les négociations collectives à venir.
Les RH doivent être prêts à intégrer ces sujets, ou à ouvrir un dialogue spécifique sur les conditions de travail estivales. Là où certains verront une contrainte, d’autres y verront un levier d’engagement et de marque employeur, notamment dans les métiers en tension où le bien-être physique devient un critère de choix.